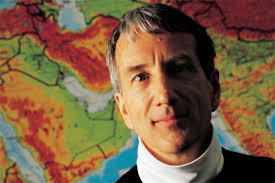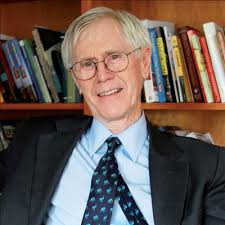En 2025, l’indice du dollar, qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de devises majeures, a chuté d’environ 9,4 %. Au cours de la même période, le taux tarifaire effectif moyen des États-Unis a augmenté d’environ 14,4 points de pourcentage, passant de 2,4 % à 16,8 %, selon le Yale Budget Lab. Pris ensemble, ces changements impliquent que, dans le domaine du commerce des importations, les États-Unis ont connu une dépréciation effective du taux de change d’environ 24 %.
Un tel scénario est politiquement intéressant pour les États-Unis, car il protège la compétitivité du secteur manufacturier et génère des recettes tarifaires supplémentaires, tandis que le dollar reste relativement stable. Cette stabilité contribue à son tour à soutenir les prix des bons du Trésor américain et d’autres actifs en dollars, réduisant ainsi le risque d’un cercle vicieux de dépréciation généralisée, d’inflation incontrôlée, de sorties de capitaux et de tensions sur les marchés financiers.
Mais le « miroir » de la balance des paiements demeure. Tant que le dollar restera la monnaie de réserve mondiale de choix, les entrées nettes persistantes de capitaux aux États-Unis – qui correspondent nécessairement au déficit courant américain – ne sont pas près de disparaître, rendant les déséquilibres structurels difficiles à résoudre. En fait, cette dynamique pourrait générer des coûts supplémentaires, qui pèseront probablement de manière disproportionnée sur les économies non américaines, en particulier les marchés émergents.
Historiquement, le dollar s’est affaibli lorsque la Réserve fédérale américaine a assoupli sa politique monétaire, que les rendements à long terme américains ont baissé et que l’appétit pour le risque des investisseurs mondiaux s’est amélioré – des conditions qui assouplissent les contraintes de financement international et augmentent la liquidité offshore du dollar. Mais cette fois-ci, les dividendes d’un dollar faible pourraient être fortement réduits, car les droits de douane agissent comme un levier qui « préajuste » les prix relatifs dans le commerce international, réduisant ainsi la dépréciation nominale du taux de change nécessaire au rééquilibrage externe.
Ce changement a trois conséquences pour le reste du monde. Premièrement, le commerce et les investissements ralentissent simultanément, affaiblissant les microfondements des retombées de la liquidité en dollars. Les droits de douane réciproques imposés par le président américain Donald Trump ont freiné la croissance du commerce mondial des marchandises. Et lorsque les flux commerciaux se contractent, la demande des entreprises en matière de financement commercial libellé en dollars et de crédit pour la chaîne d’approvisionnement diminue, et la création transfrontalière de dollars ralentit en conséquence.
De plus, en octobre 2025, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a noté que les investissements directs étrangers mondiaux sont restés faibles – en baisse de 3 % au premier semestre 2025 – et que l’incertitude persistante en matière de droits de douane a incité les investisseurs à adopter une attitude attentiste. Cela signifie que même si le billet vert s’affaiblit en termes nominaux, la périphérie pourrait recevoir moins de liquidités en dollars effectives qu’au cours d’un cycle de dépréciation classique.
Deuxièmement, les pressions sur les prix induites par les droits de douane font grimper les anticipations d’inflation et amplifient l’incertitude politique aux États-Unis, ce qui peut entraver la baisse des rendements à long terme et de la prime de terme, limitant ainsi la baisse des taux d’intérêt mondiaux pour les actifs sans risque. L’incertitude accrue peut également faire grimper les primes de risque dans le monde entier, atténuant les effets d’entraînement d’un dollar plus faible, notamment l’appétit pour le risque et le regain d’afflux de capitaux vers les marchés émergents.
Pour être clair, la dépréciation effective du taux de change d’environ 24 % reflète la distorsion relative des prix du côté des échanges commerciaux ; elle ne suggère pas que les prix à l’importation augmentent mécaniquement d’autant. Même ainsi, ses effets sur l’inflation et la politique monétaire pourraient apparaître avec un certain décalage et devenir plus visibles en 2026. Le Fonds monétaire international a constaté que la répercussion des droits de douane sur les prix a été jusqu’à présent relativement modérée, mais que les effets pourraient être retardés. Dans le même temps, il a souligné que la hausse des droits de douane et l’incertitude compliquent les compromis auxquels sont confrontés les banquiers centraux.
Troisièmement, les marchés émergents seront confrontés à des chocs asymétriques et à une réduction de leur marge de manœuvre politique. Comme je l’ai déjà souligné, les droits de douane « réciproques » creuseront le fossé entre le Nord et le Sud, car les pays à faible revenu sont souvent frappés par des taux plus élevés. Dans cette situation, la faiblesse des exportations et la baisse des entrées de capitaux conduisent plus facilement à un ralentissement de la croissance et à une dépréciation de la monnaie, un piège dont les décideurs politiques ont du mal à se sortir.
La dépréciation monétaire peut à elle seule déclencher une inflation importée ou alourdir le fardeau de la dette libellée en dollars, plaçant les banquiers centraux dans la position difficile de devoir trouver un équilibre entre les écarts de taux d’intérêt, la stabilité des taux de change et les interventions sur le marché des changes. Cela signifie que les conditions financières pourraient ne pas s’améliorer autant que prévu dans un contexte de faiblesse du dollar.
En bref, il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle vague de protectionnisme. Au contraire, les pressions d’ajustement ont été rééquilibrées : pour l’économie américaine, le commerce bénéficie d’une dépréciation « effective » grâce à l’écart tarifaire, tandis que le secteur financier recherche la stabilité. La pérennité d’un tel arrangement dépend toutefois de quatre conditions.
Premièrement, les avantages liés aux droits de douane doivent se traduire par des gains réels en termes de capacité et de productivité, plutôt que de rester une redistribution temporaire des rentes. Deuxièmement, l’inflation doit être maîtrisée. Si les droits de douane renforcent l’inflation sous-jacente au fil du temps, la Fed aura beaucoup moins de marge de manœuvre et les primes de terme pourraient augmenter, compromettant la stabilité financière que la stratégie vise à préserver.
Troisièmement, les économies non américaines doivent continuer à se conformer ; sinon, une augmentation des mesures de rétorsion éroderait les gains commerciaux des États-Unis et créerait davantage d’incertitude. Quatrièmement, le monde doit continuer à croire que la dette américaine est un actif sûr. Si les primes de terme continuent d’augmenter dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à la viabilité budgétaire des États-Unis, la « stabilité relative » du secteur financier s’affaiblira et pourrait se répercuter sur l’économie réelle.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie – si la relocalisation échoue, si l’inflation s’avère persistante ou si les représailles extérieures s’intensifient –, la dépréciation effective du dollar sur le plan commercial et sa stabilité continue sur le plan financier pourraient commencer à se neutraliser mutuellement, contraignant l’économie américaine à un rééquilibrage douloureux. Mais jusqu’à ce que ce jour arrive, les économies non américaines ne devraient pas supposer qu’un dollar plus faible apportera le soulagement habituel. Nous entrons peut-être dans une ère tarifaire similaire à celle que John Connally, alors secrétaire au Trésor américain, avait décrite en 1971 par la célèbre phrase « notre monnaie, votre problème ».
Qiyuan Xu, chercheur senior à l’Académie chinoise des sciences sociales, est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Reshaping the Global Industrial Chain: China’s Choices(Remodeler la chaîne industrielle mondiale : les choix de la Chine).
Project Syndicate, 2026.www.project-syndicate.org