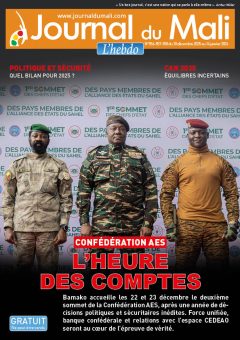Le 15 février 2024, plusieurs ministres de l’Alliance des États du Sahel (AES) se sont réunis à Ouagadougou. Suite à la réunion des hauts fonctionnaires et en prélude à la rencontre des chefs d’État, ils ont recommandé la validation de l’architecture institutionnelle pour la nouvelle confédération. Avec pour ambition d’élargir les objectifs de l’Alliance aux domaines diplomatique et économique, les États de l’alliance souhaitent concrétiser des mesures et visent à terme une union économique et monétaire. Une monnaie commune est-elle envisageable, quel délai pour son émission, quels atouts et quels risques? Ce sont quelques-unes des questions posées à notre interlocuteur Mohamed Diarra, économiste financier au cabinet d’études et conseils Nord Sud Multiservices Consulting.
Une sortie des États de l’AES de la Zone CFA est-elle inévitable ?
Cette sortie est envisageable. Mais en ce moment la Zone AES n’est pas forcément prête à sortir de la Zone CFA. Les États peuvent sortir de la Zone CEDEAO, qui est un espace économique, et rester dans l’UEMOA, qui est une zone monétaire. Ce sont des entités différentes. Ces pays vont mettre un peu de temps et devront réfléchir, parce qu’il y a beaucoup d’instruments à mettre en place. Présentement, beaucoup d’États sont en train de se financer sur le marché monétaire des titres de l’UEMOA, ce qui est une méthode de gestion budgétaire. Il semble un peu prématuré que ces États sortent de cette zone.
Une monnaie commune à l’AES est-elle possible ?
Complètement. Il suffit que les États se mettent d’accord pour le faire, mettre en place un système de banque centrale et lui donner l’autorisation d’émettre la monnaie de l’AES. Naturellement il y a d’autres aspects techniques qui précèdent sinon a ma connaissance Il n’y aucune clause ou contrainte juridique qui leur interdit de le faire. Bien entendu il y a d’autres aspects qu’il faut voir, notamment sur plan international avec la Banque de Règlements Internationaux sis a Bale en Suisse, bien que mineur. Mais lors de la création ils devront par exemple régler leurs dettes au niveau de leur compte d’opération. À part cela, il n’y a pas de problème juridique, ils peuvent librement créer leur monnaie.
Combien de temps peut prendre la création de cette monnaie ?
L’émission d’une monnaie propre à l’AES dépend des États. Décider d’émettre une monnaie est une question de convention entre eux. Il suffit d’en prendre la décision en un jour ou deux. Il s’agit de créer le cadre conceptuel et juridique et d’émettre la monnaie. C’est une question d’accord. Mais je ne pense pas qu’ils veuillent le faire tout de suite. Parce qu’il y a un certain nombre de mesures à mettre en place, qui, a ma compréhension ne le sont pas encore, une façon de dire qu’il ne faut surtout pas se précipiter.
Quels seront les facteurs de réussite de cette monnaie ?
Les facteurs de réussite d’une monnaie résident dans la capacité de gestion de cette monnaie. C’est-à-dire le sérieux que l’on met dans sa gestion. Cela signifie d’abord la maîtrise des déficits budgétaires, de l’inflation. Il y a aussi la capacité de production c’est dire le revenu réel des Etats (PNB), le taux d’inflation, la gestion des taux
d’intérêt à court et moyen terme et le maintien d’une relation stable des taux d’intérêt. En d’autres termes le respect et la maitrise de l’évolution de certains agrégats macroéconomiques. Ceux-ci sont des aspect très importants a prendre en compte.
Les pays de l’AES peuvent-ils réunir ces conditions ?
Oui.
À quelle monnaie pourrait s’arrimer cette nouvelle monnaie ?
Si on décide de créer une monnaie, il ne faut pas penser à la faire s’arrimer à une autre (ce que l’on appelle dans le jargon Currency Bord). Parce que cela veut dire laisser sa souveraineté monétaire à une autre monnaie. L’AES peut créer sa monnaie et ne pas l’arrimer. Il y a la possibilité de production de ces États, que ce soit les matières premières ou autre chose. La viabilité d’une monnaie réside dans sa bonne gestion et la capacité de production de cette zone monétaire. Arrimer sa monnaie signifie qu’on ne peut pas bien la gérer, qu’on ne peut pas la supporter. Je préfère parler de garantie. Elle peut être l’étalon or qui garantissait d’ailleurs toutes les monnaies avant la modification a travers les accords de la Jamaïque des statuts de FMI pour prendre le dollar comme monnaie de référence. Aujourd’hui presque 80% de l’affacturage international est fait en Dollar US. La valeur de la monnaie par rapport à une autre dépend de la capacité de production du pays. Donc la capacité de production de
l’AES va déterminer la puissance de sa monnaie., pour garantir le dollar par exemple. Les monnaies d’ailleurs se donnent leur valeur sur le marché monétaire. Cela veut dire qu’elles doivent trouver un espace de fluctuation. Elle ne doit pas avoir normalement, comme ce que l’on a fait avec le franc CFA et l’euro une partite fixe qui,
au demeurent ne favorise pas trop le développement de nos économies. Cette parité fixe donne même une certaine contrainte pour ne pas dire asphyxie à l’égard de nos économies. Bien entendu il y a des défenseurs de la théorie de la parité fixe. Je peux d’ailleurs m’hasarder a dire que la valeur réelle du CFA aujourd’hui est surévaluée.
La parité fixe n’est donc pas un facteur de stabilité ?
Ce sont des facteurs que l’on peut envier. Mais, en réalité, je dirais que le franc CFA est surévalué. Une monnaie se donne de la valeur en fonction de la production du pays ou des groupes de pays qui l’émettent. Je préfère une monnaie qui n’a pas de parité fixe, qui flotte en fonction de l’offre et de la demande, plutôt que la parité factuelle que nous avons entre le franc CFA et l’euro. C’est un facteur de stabilité macroéconomique. Mais que vaut cette stabilité si les peuples qui vivent dans cette zone sont pauvres?
Quels sont les éléments déterminants d’une monnaie ?
Les déterminants d’une monnaie forte dépendent de la demande. Si beaucoup d’acteurs économiques demandent cette monnaie sur les marchés, dans un premier temps cela peut lui donner de la puissance. Il y a aussi la maîtrise de l’inflation, qui est un facteur important. Le taux directeur de la banque centrale, la croissance économique de la zone qui émet la monnaie ainsi que sa balance commerciale (ses échanges), peuvent rendre une monnaie forte.
Les problèmes de sécurité ne jouent-ils pas en défaveur des États de l’AES ?
Que ce soit pour la monnaie ou pour le commerce, le problème de sécurité est un facteur de risque, mais cela n’impacte pas du tout l’émission d’une monnaie. Il faut seulement maîtriser l’inflation et faire une bonne gestion.
L’Eco(monnaie commune de la CEDEAO) est prévu pour être lancé en 2027. Cela ne posera-t-il pas un problème, sachant que les pays qui l’adopteront seront les plus nombreux en Afrique de l’Ouest ?
Non, je ne pense pas que cela puisse poser un problème. La Gambie a sa monnaie, la Sierra Leone et la Guinée aussi. Même si l’Eco était lancé, cela ne posera aucun problème de confrontation. La réussite de la monnaie réside essentiellement dans la bonne gestion macroéconomique. Il n’y a pas de crainte vis-à-vis de la Zone Eco. Il pourra y avoir des relations monétaires pour faciliter les échanges entre les deux zones, qui sont obligées de vivre ensemble.
Quels sont les atouts de pays de l’AES ?
Ils disposent de matières premières et de pierres précieuses, d’uranium, de lithium, d’or ou encore de pétrole. Ils ont aussi un potentiel dans l’agriculture. Il leur suffit d’accroître la productivité pour assurer l’autosuffisance alimentaire à l’interne, ce qui leur permettra de réduire leurs importations de denrées alimentaires. Les pays de l’AES disposent donc d’atouts pour lancer une zone monétaire. Des atouts qui peuvent permettre de gérer leurs économies et de créer une zone de prospérité économique.