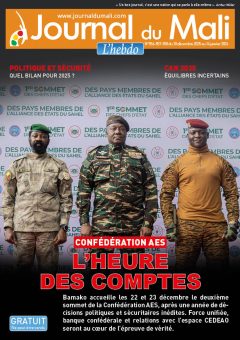Le 26 octobre 2004, le Mali a ratifié le Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes. Aussi appelé Protocole de Maputo, ce texte reconnaît des droits spécifiques aux femmes, dont celui « à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction ». Il autorise notamment l’avortement médicalisé, mais la mise en application de plusieurs dispositions de ce texte continue d’être un défi majeur.
La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples est entrée en vigueur le 27 juin 1986. Le 11 juillet 2003, les pays africains ont adopté un Protocole additionnel à la Charte africaine relatif aux droits de la femme. Sur les 55 pays africains, 44 l’ont ratifié jusqu’en juin 2023. Ce protocole compte 32 articles et consacre 24 droits spécifiques des femmes, notamment le droit à la vie, à la dignité, le droit de vivre à l’abri de la violence sexuelle et le droit au divorce.
Parmi les innovations, le texte reconnaît en son article 14 le « droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction ». Il engage les États à assurer le respect et la promotion de ces droits, qui comprennent le droit d’exercer un contrôle sur la fécondité, le libre choix des méthodes contraceptives ou encore le droit d’être informée de son état de santé, ainsi que de celui de son partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
Le Protocole de Maputo invite les États à protéger notamment « les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus ».
Le principe énoncé à l’article 14 du Protocole de Maputo institue un « avortement sécurisé » et vise à combattre l’avortement clandestin. Il obéit à des conditions de fond et de forme. L’article 14 évoque des conditions limitatives et admet l’avortement dans ces cas. Sur la forme, pour procéder à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicalisée, il faut un personnel formé dans le cadre du protocole. L’avortement doit être pratiqué par un personnel qualifié (médecin, sage-femme, infirmier) et doit se faire selon les normes et les directives imposées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le gouvernement. Cependant, l’autre aspect qui n’est pas explicitement mentionné par le Protocole de Maputo est l’âge de la grossesse.
Selon certains chercheurs, l’avortement sécurisé peut intervenir dans un délai de 3 à 5 mois. L’âge de la grossesse pour un avortement sécurisé varie de 3 à 5 mois (entre 12 et 20 semaines). Un débat qui n’est pas tranché par le protocole mais qui est pris en charge par la législation malienne, qui interdit l’avortement quel que soit l’âge de la grossesse.
Application incomplète
En ratifiant le Protocole de Maputo, le Mali s’est engagé à protéger les droits des femmes, y compris en matière de santé reproductive. Cependant, la mise en œuvre de ces engagements reste incomplète.
En 2016, l’Association malienne pour le progrès et la défense des droits des femmes (APDF) et l’Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) ont saisi la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, estimant que le Code malien des personnes et de la famille de 2011 violait plusieurs dispositions du Protocole de Maputo, notamment concernant l’âge minimum du mariage, le consentement au mariage et le droit à l’héritage. En 2018, la Cour a ordonné au Mali de réviser ce code pour le conformer à ses obligations internationales. À ce jour, cette révision n’a pas été effectuée.
Concernant les mutilations génitales féminines (MGF), bien que le Protocole de Maputo appelle à leur interdiction, le Mali n’a pas encore adopté de législation nationale prohibant explicitement cette pratique. Selon l’Enquête Démographique et de Santé au Mali 2012-2013, 88,1% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées par des praticiens traditionnels, et 71,9% des femmes et 79,1% des hommes pensent que les MGF doivent perdurer.
En matière de santé reproductive, le Protocole de Maputo prévoit l’accès à l’avortement médicalisé dans certaines situations, telles que le viol, l’inceste ou lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la santé de la mère ou du fœtus. Cependant, au Mali, l’avortement reste largement criminalisé et les services d’avortement sécurisé sont limités, contribuant à un taux élevé d’avortements non sécurisés.
Malgré la ratification du protocole, le Mali n’a pas pleinement aligné sa législation nationale sur ses engagements internationaux et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour protéger efficacement les droits des femmes.
Dépénaliser ?
Le nouveau Code pénal malien, adopté en décembre 2024, interdit l’avortement « quel que soit le moment de la grossesse », « hormis pour des motifs thérapeutiques » ou de « mise en danger de la santé et de la vie de la mère ou du fœtus ». Comme le Protocole de Maputo, il envisage l’avortement sécurisé et médicalisé. Cependant, on peut noter une divergence dans les deux approches. Alors que le protocole envisage une dépénalisation, la législation malienne maintient l’avortement comme une infraction.
Le Code pénal malien, dans ses articles 321-19 à 321-21 et le Protocole de Maputo en son article 14 abordent la question de l’avortement sous des angles différents. Bien qu’une convergence partielle se dessine avec la prise en compte de la santé physique et mentale de la femme, des écarts notables subsistent, notamment concernant l’accès élargi à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et l’approche juridique adoptée.
Le Code pénal malien (Loi n° 2024-027) prohibe l’avortement en règle générale, sauf dans des cas exceptionnels définis à l’article 321-19. L’interruption volontaire de grossesse n’est autorisée que lorsque la vie de la femme est en danger, que la grossesse est issue d’un viol ou d’un inceste, ou lorsque la santé physique ou mentale de la femme est menacée (article 321-20).
Toute interruption de grossesse pratiquée en dehors de ces cas est passible de sanctions. L’article 321-20 prévoit cinq ans d’emprisonnement, une amende d’un million de francs et une interdiction de séjour de dix ans pour toute personne pratiquant un avortement illégal. En cas d’usage de fraude, de contrainte ou de violence, la peine est portée à dix ans de réclusion. Si l’avortement entraîne le décès de la femme, la sanction peut aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement.
Les professionnels de santé sont particulièrement visés par la législation. L’article 321-21 punit les médecins, sage-femmes et autres praticiens qui pratiqueraient un avortement hors du cadre légal, avec des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une interdiction d’exercer.
Le rapport alternatif sur les droits de l’enfant, produit par le Centre pour le droit et les politiques en matière de santé reproductive (CRLP) et l’Association des juristes maliennes (AJM), révèle que 46% de la population malienne a moins de 15 ans et que les adolescentes âgées de 15 à 19 ans contribuent pour près de 14% à la fécondité totale des femmes. De plus, 42% des adolescentes ont commencé leur vie féconde, avec 34% ayant déjà eu un enfant et 8% étant enceintes pour la première fois. Le taux de fécondité des adolescentes de 15 à 19 ans est de 199 pour 1 000, tandis que 94% des femmes en âge de procréer ont été victimes de mutilations génitales. Ces chiffres soulignent l’importance de la santé sexuelle et reproductive dans cette tranche d’âge. D’autant que, comme l’ajoute le rapport, la sexualité des mineures se déroule de façon clandestine : lorsqu’elles contractent une grossesse, une grande majorité a recours à l’avortement clandestin, pratiqué dans des conditions sanitaires et hygiéniques inappropriées.
Dans une approche plus permissive, le Protocole de Maputo, texte juridiquement contraignant adopté sous l’égide de l’Union africaine et ratifié par le Mali, pose une vision plus ouverte et protectrice des droits des femmes à son article 14. Il reconnaît aux femmes le droit de contrôle sur leur santé reproductive et demande aux États d’assurer un accès sécurisé à l’avortement dans les cas suivants : mise en danger de la vie de la femme, atteinte à la santé physique ou mentale de la femme, grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste, malformation grave du fœtus.
Là où le Code pénal malien limite les conditions d’accès à l’IVG, le Protocole de Maputo élargit la liste des motifs légitimes en y incluant les malformations graves du fœtus, critère absent de la loi malienne. De plus, ce texte encourage les États à garantir un accès sécurisé à l’IVG, ce qui vise à lutter contre les avortements clandestins et leurs conséquences sanitaires.