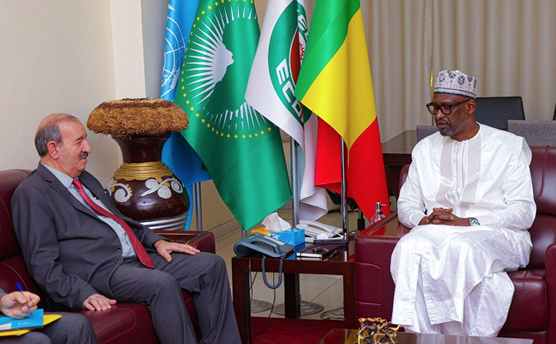L’Imam Bandiougou Traoré a été arrêté et placé sous mandat de dépôt le 10 septembre 2024 par le Pôle national spécialisé de lutte contre la cybercriminalité pour des propos controversés à l’endroit des femmes militaires et sportives, notamment. Étant déjà sous le coup d’une condamnation, cette nouvelle arrestation relance la question de la règlementation des prêches et de l’exercice de la liberté religieuse.
L’Imam Traoré doit cette incarcération à des « propos misogynes » prononcés lors d’un sermon, le 30 août 2024. Une détention intervenue malgré que le prêcheur ait présenté ses excuses après le tollé soulevé par ses propos.
L’Imam Traoré, qui est déjà sous le coup d’une sanction judiciaire, avait été condamné à 18 mois de prison et au paiement d’une amende, assorties de 16 mois de sursis, en mars 2024, avant d’être libéré. Interpellé pour « atteinte au crédit de l’État, diffusion, publication de fausses nouvelles, faites de mauvaise foi et de nature à troubler la paix publique, injures, diffamation et outrage à magistrat », l’Imam Bandiougou Traoré avait été écroué le 4 janvier 2024.
Dérapages fréquents
S’il n’en est donc pas à son premier écart, il n’est pas non plus le premier prêcheur à avoir eu affaire à la justice à cause de ses propos. Avant lui, le prêcheur Chouala Bayaya Haidara était aussi passé par la case prison. Ce dernier, poursuivi pour « atteinte au crédit de l’État et propos tendant à troubler l’ordre public », avait été arrêté en décembre 2023. Le 29 février 2024, il a obtenu une liberté provisoire pour raison de santé, après plus de 2 mois d’incarcération. Il qualifiait de détentions arbitraires notamment celles de Ras Bath, de Rose Doumbia dit « Vie chère » mais également de Madame Bouaré Fily Sissoko.
En juin 2024, le Procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a ordonné l’incarcération de Mahamadou Bassirou Kissa, alias « Karamoko Befo Junior ». Le guide spirituel de l’association « Bassirou Dine » avait été interpellé le 13 juin 2024 par la Brigade d’investigations judiciaires (BIJ) et placé sous mandat de dépôt le 14 juin par le Procureur en charge de l’assainissement du cyberespace.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où il s’exprimait sur le sacrifice du mouton pour la fête de Tabaski, il affirmait qu’à « défaut de se procurer un bélier, un devoir conjugal plus prolongé que d’habitude pouvait valablement remplacer le sacrifice d’Abraham ».
Le Tribunal de Grande instance de la Commune VI a jugé le 9 mars 2020 l’affaire Ministère public contre le prêcheur Bandiougou Doumbia, jugé pour « apologie du terrorisme, incitation à la sédition et offense au Chef de l’État ». Le Guide de « Nourredine », alors membre de la Commission nationale de contrôle du Haut Conseil Islamique Mali (HCIM), a été condamné à 2 ans de prison ferme par les juges.
Il avait été arrêté le 17 février 2020 par la Brigade d’Investigations Judiciaires (BIJ) suite à une vidéo qui avait suscité un vif émoi sur les réseaux sociaux et où il avait tenu des propos injurieux et menaçants à l’encontre du Président de la République et de sa famille. Il avait également affirmé son soutien aux terroristes Amadou Kouffa et Iyad Ag Aghaly.
Mais le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM) avait organisé une conférence de presse pour présenter des excuses au nom du prêcheur Bandiougou Doumbia et demander aux autorités de lui pardonner.
« N’est pas prêcheur qui veut »
C’est ce qu’avait estimé Thierno Hady Thiam, Imam et membre du HCIM, interrogé par Journal du Mali sur le même sujet en 2020. Le rôle des prêcheurs, qui sont formés dans les écoles coraniques et dans celles qui apprennent la jurisprudence, est « d’appeler les gens à croire à la religion ». Ils doivent donc à ce titre donner l’exemple. De même, tous les prêcheurs ne sont pas Imams et inversement. Mais au Mali, l’absence d’écoles de formation et la difficulté pour l’État de mettre en place un cadre règlementaire conduit à une gestion inadaptée de l’édifice commun autour duquel se regroupent les pratiquants. Il s’agit en l’occurrence de la mosquée.
Avant, la mosquée était celle de la communauté, construite par elle. Elle appartenait au village, au quartier ou à la ville et elle était dirigée par un érudit souvent venu d’une grande famille maraboutique et formé pour devenir Imam.
Il existe désormais une deuxième forme de mosquées, dirigées par des arabophones formés à l’extérieur ou au Mali et qui se retrouvent au chômage, quel que soit leur niveau de formation. Ils deviennent prêcheurs ou Imams d’une mosquée créée par des individus et non plus par la communauté. Rappelons que dans la mosquée de la communauté, l’Imam n’est pas payé.
Une autre forme est celle des mosquées construites par des ONG implantées au Mali et offertes aux communautés. Elles exigent souvent la nomination de leurs Imams « pour véhiculer leurs messages, ce qui peut créer les tensions », déplorait en son M. Thiam. La multiplication des mosquées et l’absence de visibilité sur leur nombre et leurs activités est un sérieux défi à l’organisation du culte musulman au Mali. Le HCIM est l’organisation faîtière des associations musulmanes et est censé, avec le ministère en charge des Affaires religieuses, parvenir à une règlementation du domaine. Mais les divergences au sein de cette organisation et l’absence de hiérarchie compromettent une gestion équilibrée, au bénéfice des Musulmans et de la communauté nationale. La relecture des lois régissant l’exercice du culte religieux, qui datent des premières années de l’indépendance, maintes fois repoussée, prouve les difficultés à réformer un secteur où les dérives peuvent compromettre la cohésion sociale. En attendant cette réforme, l’application des lois pourrait contribuer à gérer les excès ou peut être à dissuader d’éventuels récidivistes.
Appliquer les lois existantes
L’arrestation de l’Imam Bandiougou Traoré, qui peut être considéré comme un récidiviste, n’est qu’une application de la loi, relève le Dr Bréma Ely Dicko, sociologue. Ce sont en effet les religieux eux-mêmes qui avaient sollicité les autorités pour prendre des dispositions empêchant toute forme de diffamation ou de propos portant atteinte au culte. Finalement, la loi contre la cybercriminalité protège tous les citoyens et, nul n’étant au-dessus de la loi, l’Imam est aussi un justiciable. En outre, les propos dénoncés portent aussi atteinte à des droits garantis par le Mali. Afin de ne pas permettre que les prêcheurs outrepassent leur rôle pour porter atteinte à la dignité des personnes ou tenir des propos qui risquent de diviser la société, il y a besoin de tirer la sonnette d’alarme pour stopper les dérives. À défaut d’harmoniser les prêches comme dans d’autres pays, il faut surveiller de près ce qui est dit par les prêcheurs afin de maintenir la paix sociale. À ce titre, les premiers acteurs sont les représentants des différentes associations, dont la Ligue des Imams du Mali (LIMAMA) ou encore le HCIM, qui regroupe toutes les associations musulmanes, en coordination avec les ministères concernés, pour d’une part contribuer à la vulgarisation des textes afin d’informer les prêcheurs et autres représentants des fidèles de l’existence de lois en la matière. Et, le cas échéant, il faut recourir à l’application de la loi pour garantir la paix sociale. Pour maintenir la cohésion sociale, le Mali a entrepris un programme de formation des Imams. Avec le Royaume chérifien, il a signé le 22 septembre 2022, un protocole d’accord pour la formation de 300 Imams à l’Institut Mohamed VI. Environ une soixantaine de personnes seront formées lors de sessions de 2 années. Le protocole a été signé en vertu d’un accord entre le Mali et le Maroc datant de 2013 pour la formation de 500 imams au total. L’objectif de ces formations est de promouvoir les valeurs de tolérance religieuse et de contribuer au vivre ensemble.
Fatoumata Maguiraga