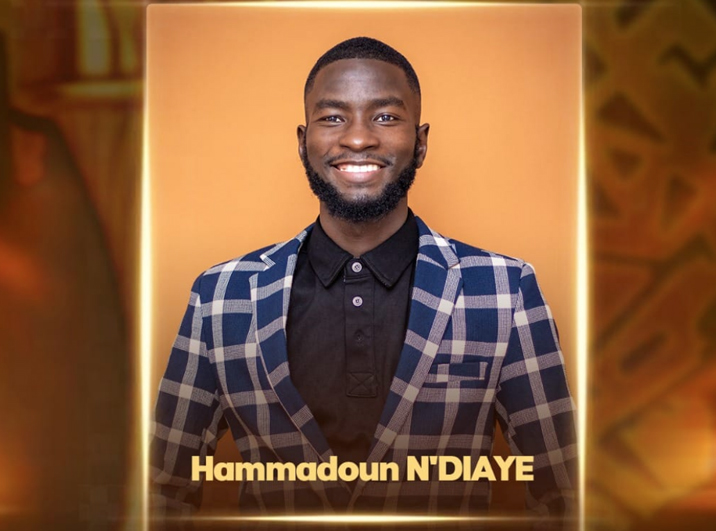Le 22 septembre fut non seulement l’occasion de célébrer le 64ème anniversaire de l’indépendance du Mali, mais aussi un jour de triomphe pour le football malien. En effet, les deux clubs les plus prestigieux du pays, le Djoliba Athletic Club (DAC) et le Stade Malien de Bamako (SMB), avec chacun 23 titres de champion national, ont ravi leurs supporters en se qualifiant pour les phases finales des deux compétitions africaines interclubs : la Champion’s League et la Coupe de la Confédération (Coupe CAF).
Après deux tours préliminaires rassemblant 58 clubs dans chaque compétition, les représentants maliens ont surclassé leurs adversaires respectifs. Le Djoliba a éliminé l’ASKO de Kara (Togo), tandis que le Stade Malien a pris le dessus sur Painesville FC du Liberia. Les deux équipes rejoindront les phases de groupes composées de 16 équipes chacune. Le Djoliba disputera la Champion’s League, tandis que le Stade tentera sa chance dans la Coupe de la Confédération. Les tirages au sort pour ces compétitions auront lieu le lundi 7 octobre. Le Djoliba devient ainsi le premier club malien à participer à la phase finale de la Champion’s League depuis la création de cette compétition en 1997, soit 27 ans après. Quant au Stade, il a déjà remporté la Coupe CAF en 2009.
Cette double qualification a insufflé un vent de fierté dans le football malien et au-delà, unissant les Maliens dans un élan patriotique. Des commentateurs enthousiastes n’ont pas hésité à qualifier cet exploit « d’historique ». Historique, sans doute, car après 27 ans d’absence le Djoliba a enfin brisé la malédiction qui semblait peser sur les clubs maliens, incapables jusque-là de figurer parmi l’élite du football continental. Néanmoins, il convient de modérer cet enthousiasme : battre une équipe relativement méconnue comme l’ASKO du Togo n’est peut-être pas un exploit aussi retentissant qu’il n’y paraît.
Le Djoliba peut-il rêver de dominer l’Afrique ? Beaucoup d’observateurs, notamment parmi les supporters et les dirigeants de l’équipe, affirment que « tout est possible » en football. Mais les ressources du Djoliba sont-elles à la hauteur de ses ambitions ? Sous la houlette d’un jeune entraîneur sérieux et ambitieux, Demba Mamadou Traoré, l’équipe malienne veut prouver sa soif de conquête. Son principal atout : la jeunesse de ses joueurs. Ces derniers sont déterminés à se surpasser, non seulement pour leur club, mais aussi pour attirer l’attention des recruteurs, présents en nombre lors des compétitions continentales.
Toutefois, les chances du Djoliba face aux géants du football africain comme Al Ahly SC (12 titres), le TP Mazembe de la République Démocratique du Congo, ou encore le club égyptien Zamalek (5 titres), l’Espérance de Tunis et les formations marocaines Raja et Wydad (WAC) semblent plus incertaines. Ces clubs bénéficient non seulement d’une grande expérience, mais aussi de moyens financiers considérables.
L’ambition n’est certes pas interdite, mais un excès d’optimisme sans réalisme peut être fatal. Le budget annuel de 2 milliards de francs CFA (3 millions d’euros) d’Al Ahly ferait tourner la tête à Tidiane Niambélé, l’honorable Président du Djoliba, dont le budget plafonne à seulement 100 millions de francs CFA.
Les finances demeurent le talon d’Achille du football malien. Selon une source proche de la Fédération Malienne de Football, Orange Mali verse 700 millions de francs CFA à la Fédération dans le cadre d’un contrat de sponsoring. Cependant, ces sommes sont modestes comparées à celles injectées dans le football d’autres pays africains. Chaque club bénéficie d’une subvention annuelle de 20 millions de francs CFA et chaque ligue régionale reçoit 4 millions.
Depuis plusieurs années, l’État malien a cessé de prendre en charge les frais des clubs participant aux compétitions internationales. Ainsi, le Djoliba et le Stade Malien doivent compter uniquement sur leurs propres ressources. La survie des clubs au Mali relève presque du miracle. Pourtant, une lueur d’espoir se profile à l’horizon : une récente rencontre entre la Fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports pourrait marquer un changement positif dans l’attitude de l’État vis-à-vis du soutien aux clubs en compétition.
Diomansi Bomboté