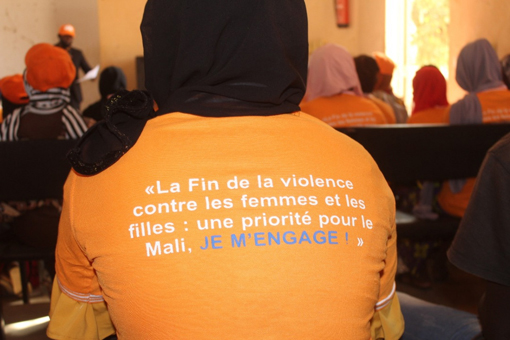Affaibli politiquement depuis sa destitution de la présidence du Comité stratégique du M5-RFP, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga multiplie les rencontres avec la classe politique, qu’il tente de rallier à sa cause. Mais la plupart des partis représentatifs de l’échiquier politique national ne répondent pas à l’appel du Chef du gouvernement. Entre le Premier ministre et la classe politique, dont il s’était déjà mis à dos une partie depuis sa nomination à la primature, le courant passe de moins en moins.
7 mars, 18 mars, 25 mars 2024. En moins d’un mois, le Premier ministre a initié trois rencontres avec la classe politique pour échanger avec elle. Mais à chacune de ces rencontres le constat était le même : la quasi-totalité des grands partis de la scène politique nationale était aux abonnés absents.
Si lors de la première rencontre, le 7 mars au CICB, on pouvait noter la participation, entre autres, de l’URD et de l’EDR, représentés respectivement par leurs Présidents, Gouagnon Coulibaly et Salikou Sanogo, les deux autres qui ont suivi ont été presque réduites à des réunions entre le Chef du gouvernement, les membres de son cabinet et quelques représentants des mouvements du M5 qui lui sont restés fidèles.
Le 18 mars, le Premier ministre a expliqué le manque d’engouement de la classe politique pour la première rencontre par une « maldonne ». « Quand j’ai demandé de convoquer la réunion, mon cabinet a fait juste un communiqué. Quand je m’en suis rendu compte, je leur ai dit que ce n’est pas comme cela qu’il fallait faire. Les chefs de partis sont ceux qui sont appelés à diriger ce pays. Il faut dès le départ souligner en rouge la considération qui leur est due. J’ai donc demandé à mon cabinet de faire une invitation que je vais moi-même signer », a-t-il expliqué à l’entame de ses propos.
Ordre du jour imprécis
Bien que l’invitation signée par le Chef du gouvernement soit par la suite parvenue en bonne et due forme aux partis politiques, cela n’a pas pour autant permis de rehausser leur présence au nouveau rendez-vous avec le Premier ministre.
Le RPM, l’URD, l’Adema-PASJ, l’ASMA-CFP, la CODEM, le parti Yelema, entre autres, sont toujours restés aux abonnés absents lors de la rencontre d’échanges du 18 mars à la Primature. La CODEM, de son côté, a participé à la rencontre du 25 mars pour ne pas « mener la politique de la chaise vide », comme l’explique son Secrétaire général, Alassane Abba. « Nous nous sommes dits que c’est le Premier ministre du Mali qui demande une rencontre avec les partis politiques et que c’est normal pour nous d’aller écouter ce qu’il a à nous dire, même si nous n’attendons rien de ses déclarations », confie-t-il.
Au RPM, plusieurs raisons sont évoquées pour justifier le « boycott ». « Nous avons décliné l’offre parce que d’abord, dans un premier temps, il n’est pas de coutume au Mali que le Premier ministre rencontre la classe politique. Par le passé, c’est le ministère de l’Administration territoriale qui était chargé de l’organisation du Cadre de concertation entre les forces vives de la Nation », affirme le Chargé de communication Sékou Niamé Bathily.
« Il y a aussi une mauvaise préparation de la rencontre, parce que dans la correspondance l’ordre du jour n’est pas précis et clair », poursuit-il, avant de révéler que le RPM avait adressé dès le 24 août 2021 une correspondance au Premier ministre pour échanger mais que cette lettre est restée sans réponse jusqu’à nos jours. « Nous sommes donc étonnés que lui, qui ne répondait pas à nos demandes d’audience, nous sollicite aujourd’hui et se pose en rassembleur ».
Par ailleurs, le parti Yelema de l’ancien Premier ministre Moussa Mara, dans un courrier adressé à Choguel Kokalla Maïga en réponse à son invitation, a également pointé du doigt l’absence d’un ordre du jour précis des échanges. « Après examen attentif de votre invitation, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons y participer. Notre décision repose sur l’absence d’un ordre du jour clairement défini pour cette réunion », indique la note en date du 23 mars 2024, signée du Président du parti, le Dr Youssouf Diawara.
« Il est aussi utile de rappeler que pendant plus de deux ans les partis politiques n’ont fait l’objet d’aucune forme de considération de votre part. Pire, ils ont été continuellement accusés par vous de tous les maux lors de vos nombreuses sorties médiatiques », poursuit la note à l’endroit du Premier ministre.
Monologue
Pour sa part, le Président de l’URD, Gouagnon Coulibaly, évoque des rencontres sans intérêt. « Dans un premier temps, moi je suis allé à la rencontre du CICB. Pour nous, c’était pour parler du pays, ainsi que des relations avec les partis et autres. Mais on s’est vite rendu compte que le Premier ministre était dans un monologue, sans véritable sujet pertinent », déplore le Numéro 1 de l’URD, qui précise que son parti, par la suite, n’a pas été invité aux rencontres qui ont suivi.
« Nous avons vu des invitations sur les réseaux sociaux. Mais l’URD n’est pas un petit parti politique, encore moins la caisse de résonance de quelqu’un, pour se précipiter dans des rencontres où elle n’est pas dûment invitée », clarifie-t-il, avant de fustiger lui aussi le manque d’ordre du jour lors des différentes rencontres.
« Dans les invitations, il n’y a aucun ordre du jour. Notre interlocuteur habituel, c’est le ministre de l’Administration territoriale, mais si le Premier ministre nous appelle, cela veut normalement dire qu’il a quelque chose de très important à discuter avec les partis. Mais si on ne discute de rien et que le Premier ministre fait son monologue et s’en va, je pense que ce n’est pas la peine », se désole l’ancien député.
Quête de soutiens ?
La première rencontre initiée par le Premier ministre avec la classe politique a eu lieu le 7 mars 2024, deux jours seulement après qu’il ait été révoqué de la tête du Comité stratégique du M5-RFP par la tendance dirigée par l’ancien ministre Imam Oumarou Diarra. Pour certains analystes, ce timing est justifié par un besoin pour Choguel Kokalla Maïga d’avoir l’accompagnement de la classe politique alors même qu’il semble de plus en plus isolé.
« Après la dislocation du M5, le Premier ministre a voulu rebattre les cartes en s’appuyant sur les partis politiques. Mais les chefs des grands partis politiques l’ont compris et c’est la raison pour laquelle ils ne se sont pas déplacés », estime le journaliste et analyste Badou S. Koba.
Issa Kaou Ndjim, Président de l’ACRT Faso Ka Welé, abonde dans le même sens. « Je pense que Choguel Maïga veut juste faire oublier ses déboires dans son propre camp, qui s’est disloqué. Il appelle les partis politiques pour essayer de se refaire une santé », accuse l’ancien 4ème Vice-président du CNT.
Des accusations que le Premier ministre balaie du revers de la main. « Certains ont pensé que c’était pour chercher des appuis auprès des partis parce que le Premier ministre serait en difficulté. En fait, ce n’était pas cela. L’objectif de cette rencontre, c’est de vous permettre en tant que futurs dirigeants de savoir ce qui s’est passé réellement pendant ces deux années », a-t-il déclaré lors de la rencontre du 18 mars.
Malgré tout, à l’Adema-Pasj également des doutes sont émis sur les vraies motivations du Premier ministre. « Depuis qu’il a accédé à la Primature, le Premier ministre a snobé les partis politiques. Pourquoi est-ce maintenant qu’il a été destitué de la présidence son mouvement qu’il veut s’entretenir avec eux ? », s’interroge le Secrétaire général Yaya Sangaré.
« Ce n’était pas de la négligence si je ne parlais pas souvent aux chefs de partis politiques. C’est parce que nous étions sur quelque chose d’ultra stratégique », s’est justifié le Chef du gouvernement devant une partie de la classe politique.
Pour autant, la plupart des dirigeants politiques ne sont pas prêts à « avaler » ce discours. Loin s’en faut. Et la « réconciliation » entre le Chef du gouvernement et la classe politique, dont il est par ailleurs issu, n’est visiblement pas pour demain.